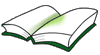|
Résumé :
|
En Algérie, la minéralisation gypsifère est très abondante, couvrant une superficie de 7966,3 km², soit 3,3 % de la surface totale du pays, et 12,2 % des sols gypseux du monde. L’hypothèse génétique la plus fréquemment admise pour la formation de nombreux gisements est celle du phénomène évaporatoire sous climat chaud et aride, lié aux époques salifères. Ainsi que leur morphologie est contrôlée par le jeu de la tectonique, qui est parfois responsable de leur mise en place, soit à leur déformation et leur déplacement. Nous avons élaboré ce travail, sur cette substance en raison de son importance économique liée à ces propriétés physico-chimiques utiles dans divers secteurs. Nous essayons de comparer deux différents compartiments éloignés, celui de Sétif et celui d'Oran, qu’ils font partie du domaine externe de la chaîne des maghrébides, dit tellien. Ces derniers se diffèrent par des phénomènes géologiques spectaculaires, d’où la région sétifienne est fortement affectée par l’orogenèse alpine qui a conduit à des remontées diapiriques, tandis que l’oranaise marquée par la crise messinienne, due à la fermeture de méditerranée. Ce travail vise à fournir des informations inaccessibles antérieurement surtout dans le nord sétifien avec une exploration préliminaire par télédétection, des missions de terrain et des stages auprès d’entreprises multinationales (Knauf) et locales (EURL Guessmia), (SEAK, GICA), qui assurent une exploitation méthodique à ciel ouvert, suivant souvent les mêmes principes de préparation préliminaire (exploitation, concassage, broyage, cuisson), pour atteindre des différents produits finis, dont celui de Sétif sont de pureté moyenne et acceptable et appartenant aux 2ème et 3ème catégories. Contrairement au gypse oranais qui est de très haute pureté et correspondant à la 1ère catégorie. Les données utilisées sont basées sur les rapports géologiques de ces entreprises, établis par CETIM et le BRGM (Lararsa Sétif).
|